À plus, La Gravelle !
Vous savez tous que le temps passe à une vitesse folle, et que plus on vieillit, plus ça va vite. Nous, on apprend autre chose pendant ce voyage : plus on bouge, plus ça va vite aussi ; et plus on découvre de choses, plus les minutes, les heures, les jours défilent à toute allure ! C’est ainsi que nous terminons actuellement nos 17 jours de wwoofing au domaine de La Gravelle, qui ont été très enrichissants tant d’un point de vue professionnel qu’humain. Et j’en passe.
Mais alors La Gravelle c’est quoi ? C’est une ferme collaborative, où on va trouver un maraîcher, une paysanne-boulangère, des éleveurs de moutons, ainsi qu’un accueil paysan. Tout ce petit monde, à une exception près, vit autour du même domaine, au milieu du village de Mortagne-sur-Gironde, entre le port et le haut du village.
Les mains dans la terre
Nous avons passé le plus clair de notre temps à La Gravelle avec Julien, maraîcher bio à La Gravelle depuis plus de 3 ans maintenant. Période transitoire, le mois de septembre est plus pauvre en récolte de légumes (une tendance davantage marquée cette année par la fraîcheur du mois par rapport aux autres années). Nous avons donc préparé pas mal de semis, et effectué masse de désherbage. Le moins qu’on puisse dire, c’est que le désherbage est une tâche variée : des pousses de carottes de 5 millimètres au mauvaises herbes presque aussi hautes que nous dans les serres, on a appris à trouver de la nouveauté même dans cette tâche répétitive !
Heureusement, Julien est quelqu’un de très pédagogue et s’il y a bien quelque chose qu’il aime, c’est son métier. Il faut dire que c’est un choix de vie mûrement réfléchi : philosophe formé à la Sorbonne, il venait d’obtenir un poste à la mairie de Paris quand il a décidé de tout plaquer pour partir en voyage avec une dizaine d’amis. Pas de simples vacances, plutôt un truc un peu comme nous : filer en voiture, en direction d’on-ne-sait-où, dans le but de découvrir le monde et surtout d’aller chercher ce quelque chose qui nous manque en ville, mais qu’on ne sait pas définir. C’est comme ça qu’il a atterri à Sillac, dans une ferme où l’accueil, la découverte et l’entraide étaient les maîtres-mots. Beaucoup de gens rencontrés, beaucoup de compétences acquises… De quoi se lancer ensuite dans un projet de rénovation d’une maison forestière… Projet qui a périclité avant de commencer, à cause d’élus locaux refroidis à l’idée de laisser une bande de jeunes créer une zone autarcique dans le coin. Après quoi Julien a décidé de faire du maraîchage son métier : une formation BPREA en poche, il trouve un stage à La Gravelle, et n’en repartira pas.
Vous comprenez mieux pourquoi il aime tant parler de son métier : au-delà de son amour pour la terre, Julien est un militant invétéré. Un habitué des soirées débat, des manif, des projets utopistes. Quand il lance un caillou sur un nid de guêpes et file en courant, on l’imaginerait presque faire la même chose avec des CRS. Sa vie ce n’est pas que le maraîchage bio, c’est « la bio », l’agriculture biologique en tant que mode de vie. Le « cultiver autrement » tant du point de vue technique, que du rapport à la terre, et du rapport à autrui. La bio c’est avant tout un tissu social dense, soudé et accueillant : au-delà du périmètre géographique restreint de la Gravelle, le réseau part chez bon nombre d’agriculteurs de la région, et s’étend bien au-delà grâce aux réseaux sociaux. Nous avons ainsi pu voir toute la troupe « gravelleuse » (ndr : désolé Julien, j’étais obligé) se préparer pour la première édition des Halles’ternatives parisiennes, entièrement orchestrée d’ici, et qui a connu un succès flamboyant.
Dans le tissu social qu’il a tissé, nous avons connu également sa femme Mélanie. Rencontrée sur Paris alors qu’il montait son utopie dans les Landes, elle mettra moins de 3 mois à tout plaquer pour le rejoindre. Ils forment à présent un solide duo, aussi bien en termes d’organisation de la ferme que de gestion des enfants, ou de répartition des blagues (l’un les aime subtiles quoi qu’un peu plates, l’autre plus cash et scabreuses, je ne dirais pas lequel).
Le cœur dans le pétrin
Mais notre séjour ici n’aurait pas eu la même teinte sans la présence de Fanny. Cette jeune paysanne-boulangère vient juste de récupérer le fournil de Denis, l’ancien boulanger de la ferme. Même si elle n’a pas pu nous faire mettre la main à la pâte au sens propre, elle nous a accueilli à plusieurs reprises dans son antre pour y admirer ses gestes précis, et lui poser toute la foultitude de questions qui nous venait à l’esprit.
Car des questions, on en avait, et pas qu’un peu. Il faut dire que le métier de boulanger nous parle. Avant de partir, déjà, on se doutait que ça serait l’une des professions phares de notre voyage. On ne s’était pas trompé : au premier jour, à peine entrés dans le fournil, l’odeur nous transporte. Un subtil mélange de farine, de levain, de feu de bois et de poussière. Le lieu sent le vécu : un vieux bâtiment en pierre avec un toit en bois, d’anciens pétrins encore maculés de farine, deux fours à pains qui ont fait leur temps, une lumière un peu tamisée, et surtout un petit poste radio qui crache du Bob Marley.
Fanny sort un énorme bac en plastique qui contient pas loin de 5 kg de levain. Curieux, cette substance à mi-chemin entre la pâte à gâteaux et l’animal amorphe. C’est blanc, ça sent acide, ça fait des bulles… Il est à point, entendez qu’il est au maximum de sa phase de vie. Car le levain vit. Rien à voir avec les levures des boulangers classiques qu’on incorpore à la dernière minute pour faire gonfler la pâte. Ici, il faut composer avec la nature. La veille de faire son pain, Fanny va bichonner son levain le matin et le soir. Le but ? Le « rafraîchir » en lui donnant à manger de l’eau, de la farine et du sel. Le levain, alors affamé, se gave et gonfle, gonfle, gonfle jusqu’à faire des bulles… Et retomber comme un soufflé par manque de nourriture, une poignée d’heures plus tard.
C’est donc à un levain gonflé à bloc qu’on admire Fanny lui redonner à becter pas loin de 10 litres d’eau et 20 kilogrammes de farine. Elle le pétrit à la main, car il n’y a que comme ça qu’on sait si la pâte est bonne. Sur sa table en bois de travail, elle soulève l’énorme masse de 20 kg (car elle sépare sa pâte en deux), la plie en deux, la ratatine sur elle-même, et l’appuie de tout son poids. Son geste est empreint de puissance et de délicatesse. C’est le nerf de la guerre : tout doit être bien mélangé pour que le levain puisse faire son boulot, à savoir digérer les amidons et les glutens, et produire un maximum de gaz. Mais contrairement aux idées reçues, nul besoin de pétrir durant des heures. Une dizaine de minutes tout au plus -et c’est déjà colossal au vu de l’effort- suffisent à notre paysanne-boulangère pour faire une pâte digne de ce nom, qu’elle laisse alors lever encore deux heures -le temps que le four chauffe- avant de la découper, la tendre, la mouler, l’asperger, la grigner, l’enfourner, la surveiller, la sortir, la vérifier, et nous la faire goûter !
Si j’insiste sur le terme « paysanne-boulangère » plutôt que simple « boulangère », c’est qu’il y a une distinction de taille à faire entre les deux familles de boulangers : les artisans et les paysans. Si les paysans-boulangers représentent tout au plus une centaine de personne à travers la France, les artisans-boulangers sont tous les autres. Si les deux font du pain, les paysans, eux, vont bien plus loin, puisqu’ils vont « du grain au pain« . Comprenez : un paysan-boulanger doit avoir une exploitation agricole modeste (une dizaine d’hectares en moyenne) afin de cultiver ses céréales, qu’il va ensuite moudre pour faire ses farines. L’artisan, lui, achètera des farines dans le commerce pour faire directement sa pâte.
Cette différence s’accompagne généralement d’une différence de mentalité. Certains artisans-boulangers, de par leur formation notamment (un CAP boulangerie) n’accorderont que peu d’importance à la qualité réelle de leurs pains. Le but est de produire au maximum pour être rentable. Les farines peuvent parfois être de qualité médiocre, quand la pâte n’est pas achetée toute faite. Le pétrissage se fait en machine, et l’utilisation de levures remplace généralement celle de pain, toujours dans un souci de rendement (la levure agit plus vite, et fonctionne presque toujours bien, donnant une mie très aérée mais qui sèche plus vite). Les paysans-boulangers, d’une formation autant agricole que boulangère, vont préférer vendre plus chères des fournées plus petites, avec une qualité de farine et de mouture excellente, et surtout un travail au levain, qui donne un pain plus dense, plus riche, plus digeste, qui se conserve sans problème une semaine, et avec ce petit goût acide si particulier.
Au travers de ces quelques paragraphes, vous aurez compris que le métier de paysan-boulanger nous a touché en plein cœur. Au-delà du simple produit, le pain, c’est tout un environnement passionnant qui s’articule autour. Le choix des variétés de blé et autres céréales, la culture biologique, le rapport à la terre, le type de mouture à rouleaux ou à meules, les farines blanches et complètes, la gestion du levain, la chimie qui s’opère dans la pâte, l’importance de tous les petits détails pour faire un pain esthétique, le travail avec le feu, l’eau, l’air, les bactérie, le temps…
On vous en reparlera.
Le poing levé
Mais au-delà de la simple technique (qui n’a rien de simple), notre séjour à la Gravelle a été une belle découverte en termes d’investissement personnel dans le réseau d’agriculture biologique. Même si notre simple présence ici était déjà un engagement, au travers du réseau WWOOF France qui promeut l’agriculture bio, l’entraide et le partage de savoirs, Julien était un fervent partisan d’autres réseaux comme Bio Consomm’acteurs par exemple.
L’événement des Halles’ternatives de Paris a également montré l’importance que les différents réseaux du bio et/ou de l’environnement accordent au fait de lancer des actions communes. Actuellement celles-ci restent à l’échelle locale, et ne rencontrent que peu d’écho à l’échelle nationale. Plus de regroupement permettrait également de gagner plus de visibilité.
Voir Julien et les autres de la ferme s’affairer autour de ces problématiques nous a donné envie de nous y investir également. Car plus que jamais, nous avons pris la réalité en pleine face : l’industrie agroalimentaire a mis en place, depuis des décennies, un système fait par et pour l’agriculture conventionnelle. Celle-ci n’a plus d’avenir, mais ce n’est pas pour autant que le bio va émerger seul. Le changement doit venir du bas, des paysans, car ce sont eux qui transmettent les bonnes valeurs.
Alors on part vers de la boulangerie bio engagée ? Pourquoi pas !
Et maintenant
J’avais commencé cet article en partant de la Gravelle…Depuis, de l’eau a coulé sous les ponts… Les ponts du canal des deux mers ! Nous avons quitté la ferme mardi, puis dépassé Bordeaux jeudi. Dès lors, nous avons pris une piste cyclable, la piste Roger Lapébie, qui nous a emmené à La Réole où nous avons découvert les sublimes rives du canal des deux mers, sous les couleurs d’automne. Nous avons descendu le canal sur environ 50 km et l’avons quitté pour longer le Lot en direction de Cahors.
Car près de Cahors, dans le village de Belaye, nous allons retrouver Marie, une paysanne-boulangère qui va nous enseigner son métier, du grain au pain, durant deux semaines. Après quoi nous retounerons au canal des deux mers, et le suivront jusqu’à Toulouse puis Sète…
On vous donnera des nouvelles !
En attendant, on remercie Julien et Fanny pour leur enseignement, ainsi que toutes les personnes de La Gravelle pour leur accueil. On espère revenir vous voir un jour !
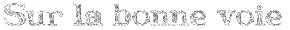

Super article très bien écrit 🙂 contente que vous trouviez quelque chose qui vous plait
Bravo pour ce très bel article au travers duquel on sent émerger une vocation!
On sent bien le retour aux sources dans ces récits !
Je pense que le « digital » aura un autre sens pour vous ensuite après avoir touché du doigt la réalité 😉
Bio et Todé même combat (sans jeu de mots).
Bel article, on a senti ton âme de philosophe émerger dans le paragraphe sur Julien ! Respect pour péricliter je crois que c est la première fois que je le lis ! Chouette que votre projet prenne forme 😉